Représentant typique de la mise en cause des responsabilités sociales dans les faiblesses de l’armée de l’Air en 1940, le capitaine Accart évoquait « l’effort soutenu par son personnel militaire pendant les années qui ont précédé la guerre, années terribles de préparation intensive où les mécaniciens d’escadrille travaillaient avec acharnement tout le jour et parfois même la nuit afin d’essayer de compenser les déficiences des usines en grève et l’insuffisance des ‘quarante heures’ »[1]. Certes marquée par le climat de l’époque, cette dénonciation, exonérant les militaires pour concentrer la critique sur la responsabilité imputée au Front Populaire reste très présente dans la littérature.
La responsabilité de cet épisode politique et social mérite d’être revisitée sans parti-pris, à la lumière de la documentation disponible, au-delà de la seule question des quarante heures. Pour l’ancien ministre de l’Air Laurent-Eynac, « la nationalisation n’a pas donné les résultats attendus : coïncidant avec la situation politique trouble de cette époque, elle s’est accompagnée d’une chute incontestable des rendements en usine, d’une crise de discipline qui atteignait le personnel d’encadrement et de maîtrise, lui enlevait toute autorité, créait, pour ainsi dire dans chaque usine, une crise intérieure dommageable à la bonne marche de la production, une fabrication de l’ordre de 400 machines, une capacité de production humiliante, a dit M. Daladier »[2], tandis que pour l’ingénieur Métral : « Parmi les causes essentielles du retard de production, il faut relever la limitation des heures de travail, l’infériorité du nombre des ouvriers spécialistes, et le faible rendement ouvrier. Nous ajouterons également la crise de la maitrise »[3].
Ce n’est pas seulement par l’enjeu d’un armement aérien retardé que l’industrie aéronautique tient une place centrale dans le débat sur les conséquences du Front populaire, c’est aussi parce que ses usines ont été de véritables précurseurs des grèves avec occupation, puis des accords sociaux salariaux ou non salariaux et des laboratoires de leur mise en œuvre parfois chaotique, comme du grand retournement de novembre 1938 qui viendra clore cette expérience marquante de l’histoire politique et sociale de la France.
Pour revisiter cette période, il convient d’abord de revenir sur l’explosion sociale de mai-juin 1936 et sur l’effet direct des grandes mesures adoptées alors : semaine des quarante heures et convention salariale. Au-delà, notre attention se portera sur les facteurs du sous-emploi massif de la main d’œuvre en 1937, puis sur les conflits de pouvoir résultant de l’organisation et du fonctionnement de la représentation ouvrière.
L’aéronautique, au cœur de l’explosion sociale de 1936
Le 3 mai 1936, lorsque la coalition de Front Populaire remporte les élections législatives, son programme de compromis, malgré de nombreuses ambiguïtés, est dans l’ensemble modéré. La pratique de cette majorité va cependant être marquée par la véritable explosion sociale, de grèves avec occupation des usines. On a parfois oublié le rôle moteur qu’a joué dans ce processus l’industrie aéronautique, qui en restera perturbée pendant plus de deux ans.
Ce sont en effet les ouvriers de l’aéronautique qui lancent la grande vague de grève, le lundi 11 mai, une semaine juste après la victoire électorale du Front Populaire, en protestation au renvoi de deux militants, en occupant l’usine[4]. Les autorités refusent l’évacuation demandée par la direction et les ouvriers obtiennent satisfaction, sur arbitrage du maire. Un scénario semblable, initié par des syndicalistes de Dewoitine, affecte l’usine Latécoère de Toulouse. C’est pourtant, le 14 mai, la grève avec occupation de l’usine Bloch à Courbevoie qui marque l’extension du mouvement. Reçus par Déat et Frossard, ministres de l’Air et du travail du gouvernement Sarrault, les délégués obtiennent de Marcel Bloch satisfaction de leurs principales revendications. Le mouvement s’étend dès lors, à Paris comme en Province. Au-delà de l’Aéronautique, il affecte le 22 mai la raffinerie SFR de Gonfreville et, surtout, les usines Renault le 28, avant de se généraliser. Formé le 4 juin, le gouvernement Blum obtiendra le 7 la signature des Accords de Matignon, amorçant un retour à la normale. L’annonce des succès obtenus dans l’aviation et l’ampleur de la mobilisation communiste au Père Lachaise le 24 mai encouragent cependant l’extension du mouvement[5].
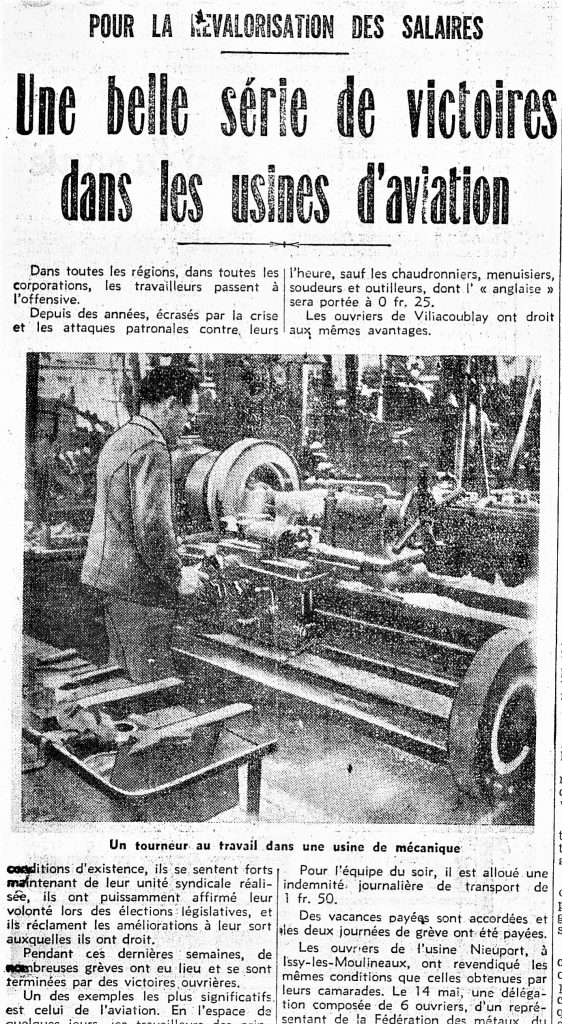
Des victoires remarquées, source: L’Humanité, 24 Mai 1936
Divers accords d’entreprises avaient assuré aux syndicats de l’aéronautique des avantages anticipant les acquis des accords de Matignon. Ces syndicats se sentent en position de force pour obtenir davantage. Pierre Cot, redevenu ministre de l’Air, force la main des patrons pour obtenir dès le 11 juin la signature d’une convention collective qui, en 32 articles, devait régler le fonctionnement de l’industrie jusqu’à la guerre. Initialement applicable à la région parisienne, cette convention allait voir étendu le champ d’application de ses dispositions principales, tandis que l’annonce de la nationalisation faisait planer une incertitude sur l’autorité des dirigeants des entreprises.
Cette convention assurait immédiatement des mesures annoncées par le gouvernement, en matière de congés payés et d’horaire de travail. Elle était particulièrement ambitieuse en matière de grille salariale : « lorsque des moyennes furent établies par catégorie de qualification, les nouveaux salaires se situaient bien au-dessus de ceux que les métallurgistes parisiens avaient touchés pendant le premier trimestre 1936 :22,7 % pour les ouvriers qualifiés, 26,7% de plus pour les ouvriers spécialisés […] Les nouveaux salaires étaient encore plus élevés dans le secteur de la construction de moteurs »[6]. Nous verrons les inconvénients que cet écart de rémunérations avec l’industrie métallurgique comportera en matière de sous-traitance et de mobilisation industrielle.
Innovation indiscutable dans son principe, mais dont l’application devait s’avérer perturbatrice, la convention instituait un système de délégués, respectivement symbole ou menace d’un pouvoir partagé dans les entreprises, selon les perceptions respectives des syndicats ou du patronat.
Ces avantages spécifiques devaient nourrir l’élargissement du mouvement dans l’ensemble de l’industrie métallurgique. « La convention de l’aéronautique amena la crise de la métallurgie parisienne à son paroxysme dès le 11 juin » ; c’est à cette occasion que Maurice Thorez, secrétaire général du Parti Communiste devait prononcer la phrase célèbre : « il faut savoir terminer une grève dès que la satisfaction a été obtenue », tandis que « lorsque les ouvriers parisiens de l’aéronautique évacuèrent leurs usines après le 10 juin, ils apparurent comme l’élite du monde syndical de la métallurgie française. [L’industrie aéronautique] était devenue la tête de pont de la réforme ouvrière sous le Front Populaire »[7].

Emblématiques des grèves de 1936, les usines Renault, source: site Louis Renault
Parmi les raisons qui peuvent expliquer le rôle pionnier des syndicats de l’aéronautique dans le mouvement de grève, on peut citer le profil bien particulier de l’emploi dans ce secteur. L’effectif total des usines d’aéronautique a été de 1929 à 1934 voisin de 12000 dans les usines de cellules et de 7000 pour les usines de moteurs, soit un total de 19000, porté à 21500 au 1er octobre 1934, à 25100 au 1er février 1935, à 35600 au 1er janvier 1936, à 35200 au 1er décembre 1936 et à 38800 au 1er septembre 1937. On remarque donc que l’augmentation principale – de 10500 en 11 mois, est intervenue en 1935, pour moitié dans les usines de cellules et pour autant les usines de moteurs, dont l’effectif s’est alors accru de 60%. « La crainte d’une remise en cause de ces recrutements récents, avec de nombreux licenciements, était d’ailleurs très présente dans les revendications ouvrières de juin » [8].
Dans son ouvrage de référence, qui a établi la contribution cruciale du gouvernement Blum au démarrage effectif du réarmement français, Robert Frank montre qu’il ne faut pas surestimer l’incidence directe des grèves de 1936 sur la production aéronautique. « Pour les grèves, la réponse est relativement aisée : elles n’ont retardé les fabrications que d’une façon saisonnière, et le second semestre de 1936 a vu se dérouler un vigoureux effet de rattrapage, y compris dans l’industrie aéronautique qui avait été la plus touchée par le mouvement de revendication : la plus grande production d’avions de guerre avant 1939 a été précisément enregistrée pendant l’année 1936 »[9]. Le constat brut est incontestable et les retards induits pour la réalisation des séries en cours peuvent ne pas apparaître importants. On relève quand même différents contrexemples, comme l’effondrement de la sortie des Potez 540 ou le retard pris par la série des Bloch 210, deux matériels en voie de déclassement. La remarque met surtout en valeur l’effondrement de la production en 1937et la lenteur du redressement engagé en 1938. Par ailleurs, l’interruption de l’activité tombait mal pour les ateliers de prototypes, et les centres d’essais, parfois privés de fourniture de moteurs ou d’accessoires essentiels à la mise au point de nouveaux modèles, d’où des retards particulièrement pénalisant pour la suite.
Le coût des 40 heures
Les débats auxquels a donné lieu l’évaluation des effets défavorables des 40 heures sur la production aéronautique illustrent bien la difficulté à écrire une histoire sereine sur un sujet aussi controversé. Face à une historiographie de droite dénonçant la loi des 40 heures comme un sabotage de la défense nationale, les historiens favorables au Front populaire en minimisent l’importance. R. Frank se fait ainsi l’avocat de ce temps fort du progrès social quand il considère que les 40 heures n’ont eu qu’un « rôle secondaire » dans le ralentissement de la production. Pour cet historien, c’est seulement « une fois que la production en grande série fut rendue possible, mais seulement à ce moment-là, [qu’] il ‘fallait’ débloquer la situation dans le domaine de la durée hebdomadaire du travail »[10]. L’argument parait justifié au regard de la sous-utilisation massive de la main d’œuvre qui prévalait, avons-nous vu, dans la plupart des usines. Il méconnait cependant l’impact de cette limitation sur des créneaux spécifiques, mais décisifs, comme les ateliers prototypes, de mise au point, ou d’élaboration des outillages en vue du démarrage de séries nouvelles.
Parmi les contemporains, le débat ne se limitait pas à l’opposition frontale des points de vue syndicaux et patronaux. De hauts fonctionnaires, ingénieurs ou conseillers d’état, se trouvent en effet en position d’arbitrage et s’efforcent de tenir un équilibre entre les intérêts en jeu. C’est en particulier le cas des rapporteurs à la Commission d’enquête sur la production, mise en place par le gouvernement Chautemps en octobre 1937 dont l’objectif n’était certes pas « de revenir sur les récentes réformes sociales mais de les faire reposer sur une base économique solide et, par des mesures d’assouplissement et d’adaptation nécessaires, d’accroître la production pour faire marcher de pair le progrès économique et le progrès social»[11]. Le rapporteur pour l’industrie aéronautique n’était autre que Joseph Roos, chef du service de la production au Ministère de l’Air. Leurs avis revêtent donc un intérêt particulier. On note d’ailleurs une différence de ton entre leur formulation très nuancée d’avant-guerre et les critiques beaucoup plus tranchées formulées après la défaite, en particulier dans leurs dépositions dans le cadre de l’instruction du procès de Riom, que nous aurons l’occasion de citer.
On retrouve sur ce point le rôle pilote de l’industrie aéronautique dans le mouvement de 1936. Joseph Roos pourra ainsi relever « le jeu des clauses [des contrats collectifs] et l’initiative prise par le Ministère de l’Air d’imposer la semaine de 40 heures dès le 27/7/36, soit plus de quatre mois avant que son application soit légalement obligatoire »[12]. L’Air précédait de peu le Ministère de la Guerre, dont l’Instruction du 27 juillet comportait formellement l’interdiction de recourir aux heures supplémentaires[13]. Toutefois, plus peut-être que la mesure initiale, le blocage exercé de facto par la CGT des mesures successives d’assouplissement dans les activités concernant la Défense nationale s’est avéré pénalisant.
La comparaison internationale était souvent invoquée pour dénoncer la situation française en matière de temps de travail. Sans nous référer à des textes partisans, citons Albert Métral qui relevait en avril 1938 : « il suffira de préciser que l’ouvrier anglais d’aviation fait en moyenne 48 heures plus 10 heures supplémentaires par semaine, soit 58 heures, que l’ouvrier allemand atteint 60 heures, l’ouvrier italien 56 heures, qu’en Angleterre, on travaille à deux postes (un de jour, un de nuit) si bien que les machines ne s’arrêtent jamais), enfin que les effectifs ouvriers sont pour l’aviation (cellules et moteurs) de 102 000 en Allemagne, 138 000 en Angleterre, 74 000 en Italie, pour nous rendre compte que la France avec ses 47 000 ouvriers travaillant 40 heures ne peut évidemment avoir la compétitivité étrangère »[14]. L’impact dommageable des quarante heures affectait essentiellement la main d’œuvre qualifiée. Dans la construction navale par exemple, un ingénieur défend la nécessité des heures complémentaires pour les spécialistes « qui conditionnent l’activité de l’ensemble du chantier » et dont le nombre insuffisant « constitue un véritable étranglement de la production »[15]. Les mêmes propos se retrouvaient dans l’aéronautique.
Dans son rapport d’Octobre 1937 sur la Situation de l’Industrie aéronautique, J. Roos pointe l’impact pénalisant des 40 heures sur l’avancement des prototypes et essais : « il est nécessaire que le contrat collectif soit revu sur ce point et notamment sur la dérogation prévue pour le personnel des essais et de mise au point des appareils nouveaux. Le Ministère avait indiqué, lors de la préparation du décret que le retard dans les essais d’un prototype pourrait différer la commande en série. Afin d’éviter des débauchages temporaires, il a été contraint de passer des commandes de série de matériels dont les essais n’étaient pas achevés »[16]. Ce à quoi Ambroise Croizat, pour la délégation ouvrière, répond que, les sociétés étant fréquemment dans l’impossibilité de donner du travail à leurs ouvriers faute d’approvisionnement, de crédits ou de commandes, « aussi bien certaines [d’entre elles] posent actuellement le problème de licenciement d’ouvriers et de techniciens qualifiés de l’aéronautique et que déjà un certain nombre d’entre eux sont sans emploi. Ce n‘est donc pas le manque de main d’œuvre qui nuit au développement de la production ». Logiquement, Croizat termine en ces termes, « nous concluons donc au rejet de toutes propositions visant à modifier le régime actuel concernant la législation sur les 40 heures »[17]. Force est de constater que, la grande désorganisation de 1937 entrainant comme nous le verrons, un sous-emploi massif du personnel, l’enjeu immédiat ne portait pas sur une remise en cause générale des quarante heures, mais sur la nécessité de dérogations ciblées. On notera au passage que le maintien de l’emploi prime alors sur d’autres critères d’opportunité pour la passation des commandes.

Ambroise Croizat avant-guerre, source: site aigueblancheautrefois.com
Le décret du 27 octobre 1936 avait prévu des dérogations au bénéfice des industries travaillant pour la défense nationale. Dans l’Aéronautique, les syndicats, en fait la CGT, en s’appuyant sur le précédent de contrat collectif pourtant échu officiellement, devait s’appliquer avec succès à en limiter l’application[18]. « Le Ministère de l’Air en accord avec le Ministère du travail a demandé en 1937 des dérogations auxquelles l’Union syndicale des travailleurs n’a pas donné accord. Des dérogations locales ont été envisagées. Comme la récupération est exigée par les délégués, les heures supplémentaires ne représentent plus qu’un coûteux déplacement d’horaires. Quelques-unes ont cependant été demandés et, en général accordées (dans 12 usines occupant 13000 ouvriers, moins de 50000 heures en 16 mois, soit par ouvrier 3 heures supplémentaires récupérées par an) »[19].
Etendant la mesure précédente, un décret du 27 Octobre 1937 établissait la légalité des heures supplémentaires dans l’intérêt de la Défense nationale, subordonnée à l’accord des organisations signataires du Contrat collectif de l’Aéronautique[20]. Cet accord sera, dans un premier temps du moins, systématiquement refusé.
On ne saurait non plus omettre l’effet indirect des 40 heures. Comme l’a affirmé Alfred Sauvy, cette réforme a contribué à casser la reprise de la production qui s’amorçait au printemps 1936 et plus durablement à hypothéquer la réponse de l’économie française aux diverses mesures visant à élever le pouvoir d’achat et donc la demande. Le point de vue de Sauvy a toutefois été contesté ou précisé. En particulier, a relevé Jean-Charles Asselain, « l’élasticité de la production s’est révélée insuffisante dans trois secteurs clés : les mines, la métallurgie et le travail des métaux »[21], ces deux derniers intervenant en amont de l’industrie aéronautique dont les approvisionnements s’en sont trouvés affectés. Les ressources budgétaires, mais aussi l’activité et l’investissement de diverses branches fournissant l’industrie aéronautique, devaient en souffrir.

Célèbre contempteur des 40 heures, Alfred Sauvy, [photo d’après-guerre], source : France Culture
Finalement, lorsqu’elles seront effectives, les mesures d’assouplissement des 40 heures se traduiront par une dérive salariale, génératrice de surcoûts pour le budget mais aussi, fait moins remarqué par les historiens, par des distorsions pénalisantes.
Une fuite en avant salariale
Le décrochage salarial, au bénéfice des travailleurs de l’aéronautique par rapport à leurs camarades de la métallurgie s’était creusé en juin 1936, la convention collective de l’Aviation ayant alors anticipé et amplifié les avantages résultant des accords de Matignon. Dans la nuit du 10 au 11 Juin, au paroxysme du mouvement de grève que vont difficilement contenir, puis éteindre les accords Matignon, Cot fait pression sur la Chambre Syndicale pour que les employeurs consentent à signer une convention de 32 articles, comportant des avantages salariaux considérables, mais aussi les bases d’un pouvoir syndical inédit dans l’industrie française[23]. Henry de l’Escaille, président des sociétés nationales devait estimer entre 10 et 35%, pour certaines régions, l’augmentation du prix de revient due à cette mesure, qui avait surtout l’inconvénient d’introduire un écart de rémunération entre les ouvriers ou employés selon l’activité concernée, comme « pour une femme de ménage, selon la nature des fabrications de l’usine dont elle nettoyait les bureaux »[24].

Louis Breguet, un patron avionneur dénonce la dérive salariale, source: Le Point
Loin de se résorber, la divergence va se trouver confortée par les compensations obtenues en contrepartie des diverses mesures de dérogation aux 40 heures. De plus, « la vague de grèves qui déferla sur l’industrie métallurgique parisienne au cours de la dernière semaine de Mars 1938 mit fin à la trêve difficile qui régnait depuis presque 2 ans dans la plupart des usines aéronautiques »[25], maintenant ainsi la pression sur les employeurs, et surtout sur le Ministère.
Tout autant que l’augmentation générale des salaires, c’est l’écrasement de leur hiérarchie, acté par l’accord du 11 juin 1936, particulièrement favorable à la rémunération des personnels non qualifiés, qui a été particulièrement dénoncé par le patronat de l’aéronautique. Pour Marius Olive, à l’époque directeur de Bréguet avant de prendre la tête de la SNCAO, « la fixation des salaires de ces personnels qui a eu pour effet de porter atteinte à la rétribution équitable de la valeur professionnelle est due aux pressions de M. Pierre Cot. Le salaire de ‘la femme de ménage de l’aéronautique’ est, depuis cette époque, devenu une sorte de slogan dans les milieux industriels »[26].
Le mouvement des salaires dans l’industrie aéronautique pendant les gouvernements de Front Populaire, ressort bien du tableau suivant, joint à un article de Louis Breguet dans la Revue des Deux Mondes, en 1939. Ces données établies pour la région parisienne, sous-estiment les augmentations intervenues en province.

Cette dérive salariale, génératrice de surcoûts pour le budget, s’est aussi avérée, fait moins remarqué par les historiens, source de distorsions pénalisantes. Comme le remarquaient les journaux, le traitement privilégié des employés de l’aéronautique posait problème vis-à-vis des mécaniciens de l’Armée de l’Air. La distorsion existant avec les salaires de l’industrie mécanique, dont l’automobile, était certes favorable à la mobilité de travailleurs, répondant ainsi au besoin de main d’œuvre requis pour l’exécution du Plan V, mais n’allait pas sans poser de difficultés nouvelles. Joseph Roos devait ainsi relater que « pendant toute l’année 1938, j’ai convoqué et reçu de nombreux industriels qui m’ont refusé leur concours, par suite de l’importante disparité qui existait entre le contrat collectif de l’aviation et celui de la métallurgie. Ces industriels redoutaient, à juste titre, qu’en consacrant aux fabrications aéronautiques un de leurs ateliers et en appliquant de ce fait, dans cet atelier, le contrat aéronautique, ils créent dans leur usine, un germe de difficultés sociales »[27]
Il n’est pas étonnant dans ces conditions que, le 15 Décembre 1938, lors d’une délibération tenue dans le bureau du Ministre de l’Air, en présence de Jacomet, où devait être évoquée la possibilité de décréter la mobilisation industrielle prévue par la loi sur l’organisation de la Nation en temps de guerre, il ait été acté que « il serait éminemment nécessaire que dans le plus bref délai et par telle procédure jugée convenable, notamment sous l’égide du Ministre du Travail, on arrive à un régime uniforme de la main d’œuvre qualifiée dans les différentes usines travaillant pour la Défense nationale, la différence de régime existant actuellement étant le principal obstacle aux ressources considérables que pourrait offrir l’industrie automobile (et toutes les autres) au bénéfice de l’industrie aéronautique »[28].
Après une pause du printemps à l’été 1937, la hausse des salaires dans l’aéronautique devait reprendre en 1938. « La vague de grèves qui déferla sur l’industrie métallurgique parisienne au cours de la dernière semaine de Mars 1938 mit fin à la trêve difficile qui régnait depuis presque 2 ans dans la plupart des usines aéronautiques »[29] . Cependant, la situation avait bien changé depuis 1936 et « en conséquence, bien que la CGT soit bien plus forte en1938, elle n’était pas en mesure de dicter un accord de fin de grève […] « Une fois de plus, comme en Juin 1936, l’intervention du gouvernement fut nécessaire pour régler la question. Blum fit une proposition à toutes les entreprises impliquées dans la production concernant la défense –une augmentation des salaires de 7% en échange d’une semaine de 45 heures. Très désireux de favoriser le réarmement tout autant que de le maintenir au pouvoir, les dirigeants de la CGT en acceptèrent le principe, pour voir les patrons la rejeter comme une augmentation salariale trop coûteuse. Lorsque le gouvernement Blum tomba le 8 Avril et qu’Edouard Daladier arriva au pouvoir, Robert Jacomet [secrétaire général du Ministère de la Défense] était nommé surarbitre. Le 12 Avril, il proposa aux patrons le même marché en y ajoutant une clause incitative : que les heures complémentaires entre la quarantième et la quarante-cinquième seraient payées, non pas en heures supplémentaires, mais au tarif ordinaire. En contrepartie, le salaire horaire était augmenté de 0.75 F. Les chefs d’entreprise acceptèrent cet arrangement qui fut officiellement conclu sous le nom de décision d’arbitrage Jacomet, suivie 2 jours plus tard de la signature d’une nouvelle convention collective »[30] . La CGT avait obtenu que cette convention, et en particulier ses clauses salariales, s’appliquent aussi en province, avec un abattement maximal de 18% sur les salaires parisiens. La représentation syndicale, et son pouvoir sur les embauches et les licenciements, était aussi renforcés. A ce prix, l’industrie aéronautique connaissait enfin un véritable assouplissement des 40 heures. Malgré l’opposition du patronat, Ramadier, alors ministre du travail, étendit, par décret du 5 Août, le champ de la convention.
L’impact des quarante heures et la dérive salariale constituent les effets directs les plus visibles des réformes sociales de 1936. Coïncidant avec la mise en œuvre des nationalisations, mais aussi avec l’épuisement retardé des programmes de production en cours, ces mesures n’allaient constituer que des facteurs parmi d’autres de la grave crise de la production aéronautique en 1937.
1937 : annus horribilis, désorganisation et sous-utilisation
Le second semestre de 1936 avait été une période d’attente, dans la perspective des nationalisations votées le 11 août, mais dont la réalisation devait s’échelonner du 15 novembre (création de la SNCASO) au mois d’avril 1937 avec la création tardive de la Société du Midi. On aurait pu penser que la concrétisation du dispositif institutionnel, levant les incertitudes, allait permettre un redémarrage rapide de l’activité. Loin de là, les facteurs de blocage s’accumulant, l’année 1937 devait être pour la production aéronautique une annus horribilis, une année perdue.
Si la réorganisation des relations entre établissements demandait des délais inévitables, le sous-financement manifeste des nouvelles sociétés devait handicaper le démarrage de leur activité, comme le dénonçait Albert Métral : « La création des Sociétés Nationales a été poursuivie par les Finances dans la méconnaissance totale des nécessités financières d’une société industrielle. Créer, en effet, au capital de 100 000 francs (1/4 versé) des Sociétés anonymes chargées d’exécuter des commandes annuelles de plus de cent millions de francs, sans assurer la trésorerie de ces organismes, est une folie qu’aucun industriel ou financier ne commettrait jamais »[31].
La déstabilisation des relations internes aux établissements est un autre facteur important, bien que moins connu, de cette situation. Moins massifs qu’en 1936, les mouvements de grèves sporadiques contribuaient à cette stagnation. Ils étaient également le signe de tensions internes persistantes. Ainsi, par exemple, « Breguet avait connu des problèmes du même ordre [que Renault] de juin à octobre 1937, et rien n’avait pu ‘sortir’ de Vélizy. En temps ordinaire, les équipes travaillaient mollement, maintenant, freinage et coulage se généralisaient »[32] .

Appareil dépassé, le Potez 540 voit sa production s’étirer jusqu’en 1938, source: maquette Heller
Loin de s’accompagner d’une augmentation de la productivité horaire, comme on aurait pu l’attendre, la réduction du temps de travail s’accompagnait d’une dégradation supplémentaire, que Joseph Roos analysait en ces termes :
En 1937, par rapport à 1935, « pour un rapport des effectifs de 1541/1030, le rapport de production a été de 100/90, ce qui correspond à un rapport des rendements annuels de l’ouvrier de 74/100 […]. La durée du travail a été réduite dans le rapport 78/100 [2600 h/2000h] Le rendement horaire de l’ouvrier aurait donc varié dans le rapport de 74/78 soit 95% ». Parmi les explications suggérées par Ross, « la suppression du boni ou sa moindre efficacité dûe au niveau élevé des salaires minima a nui légèrement au rendement »[33].
Beaucoup plus important parait un effet lié à la faible utilisation productive de la main d’œuvre. L’année 1937 voit culminer un phénomène de sous-utilisation massive, conséquence d’importantes restrictions budgétaires affectant principalement les crédits d’équipement de l’Armée de l’Air en raison d’une masse salariale incompressible. Une note du printemps 1938 considère d’ailleurs que la production de 1937 (470 appareils) n’a représenté que le tiers d’une production « donnée comme normale » avec les moyens disponibles (1460), les meilleurs résultats de ce point de vue étant réalisés par Sud-Ouest et Centre (40%), les pires par Ouest et Sud-Est (environ 20%)[34]. Compte tenu de la dispersion des commandes entre les diverses usines, il est bien difficile de rapprocher ces taux de sous-utilisation des retards apportés à la production de modèles spécifiques.
On comprend qu’au moment d’engager l’effort de production requis pour la réalisation du Plan V, ce document ministériel relève, en termes certes diplomatiques, que cette anomalie ne peut perdurer : « Il est certain qu’une production effective aussi inférieure à celle qui est donnée comme possible a pour résultat une augmentation considérable des prix de revient. On ne saurait, comme les Services Techniques le proposent, s’engager dans une politique d’augmentation de l’outillage qu’en obtenant dans le même temps des usines nationalisées qu’elles produisent au plein de leur capacité actuelle. Ce qui n’est pas sans engager la politique sociale du Ministère de l’Air »[35]. Roos devait par ailleurs reconnaître qu’« en 1937, l’effectif ouvrier était très difficilement maintenu, par suite de l’insuffisance des crédits »[36].
Malgré les grèves et les perturbations qui les avaient suivies dans les usines, l’industrie avait produit, en 1936, 569 avions d’armes, pris en charge par le CRAS, un résultat en progrès donc par rapport aux 420 acceptés en 1935.Il faut voir là le débouché, certes tardif, de l’effort engagé en 1934, mais ralenti en 1935 du fait de l’austérité budgétaire. En 1937, la production s’effondre de 35%, à 370 appareils. Certaines séries tardent à s’achever, comme celle du Potez 540 ou celle, plus modeste, du Loire 60, tandis que la relève des séries terminées prend du retard (Dewoitine 510 succédant au D500-501, Bloch 210 au B200).
Il convient de noter que ce déficit de production devait largement persister en 1938. Il était inévitable que 1938 soit une année de transition. Cela apparait lourdement dans les données d’utilisation de la main d’œuvre. Selon un tableau établi début 1939, 10 millions d’heures de fabrication ont été effectuées pour produire 1010 avions, soient 10129 heures par appareil. Mais le nombre total « d’heures passées » (sic) est plus du triple (34 millions d’heures, en excluant la SNCAM qui n’a produit que 12 avions, exigeant chacun 40 000 heures). Le ratio normal effectif total/productifs, dans une industrie bien rodée, devrait être de l’ordre de 150%, ce qui représente quatre fois moins de main d’œuvre non directement productive ou, encore, deux fois moins de main d’œuvre pour la même production totale ! « Quelle que puisse être la largeur des évaluations de ces différents postes, il est impossible d’expliquer les déficits constatés. On ne pourrait expliquer dans ces conditions qu’un déficit de 30 à 40% (grand maximum) ; le reste ne peut être, en première analyse qu’imputé à un défaut d’organisation intérieure aux usines. Il n’est pas dès lors étonnant que les Sociétés nationales se trouvent en désaccord avec les services d’État sur la fixation du taux des frais généraux auquel elles doivent travailler ».
Ces données montrent l’ampleur du problème d’organisation et de sous-financement que connaissait l’industrie aéronautique française, en sus de ses insuffisances en machines et équipement modernes[37].
Représentation syndicale et conflits de pouvoir
On retient principalement de cette période la nationalisation de l’essentiel de l’industrie aéronautique. On sait moins combien l’engagement de l’État en faveur des ouvriers a modifié les relations sociales. Le poids donné aux organisations syndicales, s’il peut être vu dans le long terme comme un moment de rééquilibrage nécessaire d’un système marqué par l’autoritarisme patronal, n’allait pas sans déstabiliser le fonctionnement des entreprises, en particulier au niveau des ateliers.
La nationalisation avait pérennisé à la direction des entreprises les administrateurs des principales sociétés privées : d’abord Henri Potez et Marcel Bloch, respectivement à la SNCAN et la SNCASO, mais aussi les moins convaincants Louis Arène, directeur de Lioré & Olivier à la SNCASE, Outhenin-Chalandre, d’Hanriot, à la SNCAC, et Marius Olive, numéro deux de Breguet, à la SNCAO. Le président de la Chambre syndicale se retrouvait coiffer le dispositif comme président des cinq sociétés. Bien sûr, ces nouveaux administrateurs délégués devaient compter avec un conseil d’administration de composition bien différente. La nomination à la tête des sociétés nationales d’anciens patrons des sociétés privées n’allait pas sans susciter la déception et l’inquiétude des organisations syndicales. C’est dans ce contexte que les négociations de février 1937 aboutirent à instituer quatre niveaux de représentation dans les Sociétés Nationales :
-deux représentants de la CGT, un cadre et un ouvrier, au Comité de coordination de ces sociétés ;
-un représentant au CA de chaque société ;
-un comité consultatif d’usine, « strictement consultatif », devant examiner « les questions relatives à l’organisation du travail, au rendement de la production et à la coordination des efforts pour la bonne marche de l’usine » ;
– les délégués syndicaux élus, instaurés par la Convention collective de juin 1936 complétaient le dispositif et pouvaient intervenir sur les cas individuels.
Contributions incontestables au progrès social, ces mesures étaient d’autant moins bien vécues par les responsables d’entreprises que le ministère Cot était perçu comme un allié des syndicats pour miner leur pouvoir de direction, plus que comme arbitre représentant d’intérêts supérieurs. De nombreux témoignages attestent de cette perception, qui méconnait le rôle de modérateur exercé par le ministère. En particulier, la nomination à la tête des sociétés nationales d’anciens dirigeants des entreprises privées, avait suscité la déception, voire le ressentiment de responsables syndicaux qui appelait un geste en faveur de la représentation syndicale.
Pour dangereux qu’il ait été perçu par les milieux patronaux, ce dispositif paraissait insuffisant aux yeux de certains syndicats CGT, en particulier la nouvelle fédération des techniciens et sa section aéronautique, plus idéologue que la Fédération des Métaux. « En 1937, ce syndicat publia une brochure dans laquelle le contrôle des ouvriers devait compléter la nationalisation. « Il ne suffisait pas que l’Etat achète les usines : ‘la fédération place au premier plan des revendications le contrôle ouvrier exercé par tout le personnel des usines nationalisées sur la gestion, par l’intermédiaire des délégués élus et constamment révocables par lui’ »[38].
Les milieux aéronautiques devaient être particulièrement sensibles au discours prononcé par Cot à l’occasion de l’inauguration de l’usine de Bouguenais le 20 juillet 1937 : « L’autorité n’est pas la dictature. Il est bon que le monde du travail sache que rien ne sera décidé au conseil d’administration sans que ceux en qui il a placé sa confiance aient dit leur mot, fait entendre leur voix et participé à la décision prise »[39].

le 20 juillet 1937, Cot à Bouguenais, source : L’Air, août 1937
Selon une étude de Roos en Novembre 1937, les lois de 1936 ont entrainé une réduction des rendements de 5% au-delà de l’effet arithmétique de la diminution des heures travaillées. Cet effet a priori inattendu s’explique par de nombreuses raisons : la réduction de la discipline, la désorganisation de nombreuses usines et la suppression de la rémunération aux pièces. Sur ce point, des employeurs signalaient que des primes au rendement avaient peu d’effets incitatifs en raison du niveau élevé des salaires de base. Dans son rapport, Métral signalait un système mixte préconisé par la Société d’organisation Bedeaux et pratiqué par certaines maisons anglaises : « les ouvriers travaillent à l’heure pour les prototypes et les débuts de fabrication de série, puis avec des systèmes de primes (Bedeaux, Rowan etc…) lorsque la série est parfaitement définie ».
« Quand les occupations d’usine ont cessé, le travail n’a repris qu’avec une extrême lenteur, et très partiellement. Les directeurs d’usines et la maitrise n’avaient plus aucune autorité, les délégués ouvriers étaient maitres de l’usine, ils harcelaient continuellement la direction de réclamations de tous ordres, souvent appuyées par des menaces d’occupation quand ce n’était pas par l’occupation de quelques ateliers, de sorte que les directeurs d’usines étaient exclusivement occupés à répondre à leurs délégués. Il semble bien que l’attitude du ministre à leur égard les ait vivement encouragés dans cette voie ; il m’a en effet été rapporté par un directeur d’usine, avec qui j’examinais comment il pourrait reprendre de l’autorité, que s’il voulait voir le ministre pour obtenir son appui, la porte lui était systématiquement fermée, alors que tout délégué ouvrier qui se présentait à son cabinet était immédiatement reçu. Par ailleurs, à bien des endroits, les délégués limitaient la tâche que devaient faire les ouvriers à un maximum que ceux-ci ne devaient pas dépasser sous peine de sanctions. J’ai eu connaissance de ces faits par mes contrôleurs qui circulaient en permanence dans les ateliers […] La mentalité ouvrière n’a vraiment changé qu’après le 30 novembre 1938, quand le gouvernement a décidé que l’on ne reprendrait pas un certain nombre de meneurs. Encore n’a-t-on pas tiré parti pleinement de cette situation à l’époque où la mentalité était telle que l’on aurait pu retrouver un excellent rendement en étant un peu sévère » [40].
L’accord passé par Cot avec la CGT le 15 Février 1937 ne prévoyait pas moins de 4 niveaux de représentation syndicale, respectivement de la coordination des SNCA, du Conseil d’administration de chaque Société, du conseil d’usine et de délégués d’ateliers. En Avril 1937, le contrôle ouvrier sur les embauches est assez effectif pour que le Groupement des Industries Métallurgiques et Métalliques s’en inquiète, craignant une possible contagion. Le contrepouvoir syndical se nourrit aussi du soutien de Cot et de son cabinet. Bien qu’elle n’ait duré que quelques heures, la visite déjà évoquée du ministre à Bouguenais et Saint Nazaire le 20 Juillet 1937 illustrait bien ce soutien, comme on peut en juger par ce passage de son discours en défense des nationalisations : « l’association du monde du travail à la gestion des entreprises ne peut affaiblir en aucun cas l’autorité, mais au contraire la renforcer, les délégués de la CGT agissant uniquement comme mandataires de l’Etat pour exprimer l’intérêt général ».

Andraud, secrétaire d’état et Jean Moulin, directeur de cabinet, source : L’Air, août1937
Fait intéressant, c’est dans les pages du Populaire, l’organe du Parti Socialiste, que l’on trouve relatée une anecdote qui vient jeter un trouble sur le succès de la cérémonie. En effet, relate le journal, « l’effort accompli [pour achever l’usine] est si méritoire qu’il se suffisait à lui-même. Nous avons peine à comprendre certaines manœuvres de ‘poudre aux yeux’ parfaitement superflues. Sur le terrain d’atterrissage voisin de l’usine, on nous a montré, à côté de la maquette, le premier Bloch 210 sorti des ateliers. Or, cet appareil nous rappelé les fameux villages de Potemkine. Monté en toute hâte pour la visite ministérielle, assemblé tant bien que mal à grands renforts d’heures supplémentaires, il devra sans doute être complétement redémonté et reconstruit avant de pouvoir voler. Coût : plusieurs dizaines de mille francs »[41]. Les journaux aéronautiques spécialisés ne reprenaient pas cette critique, visiblement inspirée par des militants syndicaux, et dont la cible est clairement désignée par les lignes suivantes : « Le directeur, M. de Broë, aurait sans doute fait davantage attention avant de gaspiller la main d’œuvre s’il avait craint de prêter le flanc aux campagnes fascistes sur la ‘baisse du rendement’ de celle -ci. Ne nous a-t-on pas affirmé que dimanche, pour préparer la ‘revue’, il avait fait balayer les locaux par des ouvriers spécialisés, au double tarif, soit 12 francs par jour, quand à Nantes tant de pauvres auraient pu faire ce petit travail. La ‘moyenne’ ne sera pas améliorée par de tels procédés ». Dans un tel climat, on ne s’étonnera pas que, peu de temps après cette visite, où un long aparté de Jean Moulin avec les délégués syndicaux avait été remarqué, le directeur de l’usine, de Broë, ait été remplacé par son adjoint, M. Cheveaux, « très front populaire », qui se serait entouré de collaborateurs communistes militants[42]. Louis Breguet lui-même avait gardé le souvenir de la relation étroite des représentants ministériels avec les syndicats, « le sous-secrétaire d’état à l’aviation [Andraud], adjoint de Pierre Cot, est arrivé le matin et, après un premier tour de l’usine, s’est isolé pendant plus d’une demi-heure avec les seuls délégués ouvriers de l’usine, en dehors de la présence de l’administrateur-délégué et des directeurs, laissant attendre les autorités, ce qui a créé un certain malaise »[43].
Henry de L’Escaille, président des sociétés nationales, exprimera un sentiment largement partagé par les industriels : « la caractéristique des relations avec le Ministère était l’écart systématique du personnel de direction au profit des représentants du personnel ouvrier et technicien ». Au-delà, « ce qui plaisait aux ouvriers et inquiétait les patrons, c’est, entre autres, l’empressement de Cot à s’impliquer dans les conflits d’usines »[44].
Si l’on parfois exagéré l’impact de la loi des 40 heures, d’autres aspects du climat social nous paraissent avoir joué un rôle aussi important que méconnu. Loin de se limiter aux actions de grève explicites, la contestation syndicale d’un pouvoir patronal souvent incapable de se renouveler a clairement pesé sur la production. Comment en effet obtenir la précision dans l’exécution des tâches, gage de la fiabilité des fabrications, ou les cadences soutenues exigées par les objectifs de production, dans des usines où l’autorité de la maîtrise est régulièrement battue en brèche.
L’industrie aéronautique, aux méthodes souvent restées artisanales, pratiquait largement le salaire aux pièces. Nous pouvons ainsi comprendre l’affirmation d’Antoine Prost: « beaucoup plus que les 40 heures, n’en déplaise à Sauvy, c’est ce retour à des cadences ‘naturelles’ qui explique que la production industrielle ne soit pas repartie comme le gouvernement l’escomptait. Le travail a repris près les grèves, mais pas comme avant »[45]. La philosophe Simone Weil, témoin engagé des luttes ouvrières, décrivait ainsi la situation dans les usines du Nord : « Sur le papier, le travail aux pièces est maintenu, mais les choses se passent dans une certaine mesure comme s’il n’existait plus ; en tout cas la cadence du travail a perdu son caractère obsédant, les ouvriers ont tendance à revenir au rythme naturel du travail ». Aussi libre que lucide dans ce rapport à ses camarades de la CGT, la philosophe ajoutait : « Mais en même temps, à la faveur du relâchement de la discipline, la mentalité bien connue de l’ouvrier qui a trouvé une ‘planque’ a pu se développer chez certains. Et ce qui, du point de vue syndicaliste, est plus grave que la diminution de la cadence, c’est qu’il y a eu incontestablement dans certaines usines diminution de la qualité du travail, du fait que les contrôleurs et vérificateurs, ne subissant plus au même degré la pression patronale et devenus sensibles à celle de leurs camarades, sont devenus plus larges pour les pièces loupées. Quant à la discipline, les ouvriers se sont senti le pouvoir de désobéir et en ont profité de temps à autre. Ils ont tendance, notamment, à refuser l’obéissance aux contremaîtres qui n’adhèrent pas à la C. G. T »[46]. La perte d’autorité de la maitrise est un facteur essentiel du changement impulsé par ce moment du Front Populaire. Là même où le système Bedaux, systématisant le salaire ‘aux points’ n’est pas abandonné, « les contremaîtres, discrédités et mal soutenus par la hiérarchie ne parviennent plus à faire respecter les cadences. Dès qu’ils le tentent, les délégués élus par les ouvriers font débrayer l’atelier »[47].
Il est intéressant de remarquer que même les sociétés à la direction la mieux établie n’échappaient pas à cette difficulté. En particulier, Henry Potez et Marcel Bloch, grands bénéficiaires de la nationalisation, ne souhaitaient entrer en conflit avec les syndicats. En Octobre 1938, la visite de l’usine de Méaulte, fleuron de l’industrie française dépendant de la SNCA Nord que dirigeait Potez, par des officiels britanniques, est l’occasion d’un constat désagréable, ainsi relaté au Comité du Matériel le 14 Octobre 193 : « le général Vuillemin dit que si Potez voulait travailler, on aurait des A3 (637 et 63-11) à utiliser à la place des T3 mais au cours de la visite faite à Méaulte par la mission anglaise, on a pu constater que les ouvriers de cette usine étaient mal employés. C’est une question d’organisation qui n’a pas échappé au Maréchal de l’Air Newall lui-même »[48] . Selon les notes de l’ingénieur général Joux, Directeur Technique, le nouveau président des Sociétés Nationales, Albert Caquot, partageait ce point de vue : « Potez a une réduction de rendement de 30% et la situation reste mauvaise en général car les ouvriers ont perdu leur temps à faire des réunions. Tout est à reprendre car les cadres sont dégoûtés »[49].

Note de Joux, directeur technique et industriel, en octobre 1938, source SHD AI Z10802
La SNCASO est l’objet de constats semblables. On signale chez Bloch [sic], à Suresnes, l’exemple de responsable syndical se livrant impunément à des actions d’obstruction[50]. Après la défaite, l’ingénieur Pierre Franck s’associe à cette mise en cause : « dans l’été 1938, quand j’ai pris la direction du Service de Fabrication de l’Aviation, le travail ouvrier était encore lamentable dans certaines usines : usine de la Société Nationale du Sud-Ouest à Châteauroux, où l’on voyait les ouvriers reprendre leur outil ou jeter leur cigarette au moment où l’on entrait dans l’atelier »[51]. C’est toutefois à la Société Nationale de Construction des Moteurs, issue de la nationalisation partielle de l’usine des moteurs Lorraine, que revient la palme des échecs de la nationalisation. « Chez les motoristes, il régnait une grande confusion. Depuis la ‘nationalisation’ de mai 1937, des centaines d’ouvriers étaient venus s’embaucher à la SNC Moteurs pour gouter aux délices de son ‘soviet’. Le 15 septembre 1938, Argenteuil employait 2729 personnes »[52] pour une production pratiquement nulle.
Problèmes de qualification et de formation
A côté des sujets conflictuels, la question de la formation des personnels en vue de répondre aux besoins de main d’œuvre est, avec raison mise en avant par les représentants syndicaux comme par les ingénieurs d’État, mais inégalement et parfois tardivement prise en charge par la direction des sociétés nationales comme ‘libres’, selon l’expression alors employée pour désigner les entreprises privées, non nationalisées.
« L’insuffisance de main d’œuvre qualifiée est une constatation qui vaut non seulement pour l’aéronautique, mais pour la construction mécanique en général. Ce grave problème qui revêt instantanément une gravité exceptionnelle pour la Défense Nationale dépasse largement le cadre de ces industries spécialisées. Il est indiscutable qu’il faut envisager la création ou l’amplification de centres de réadaptation de main d’œuvre et de développement de l’apprentissage [53] […] Dans ces conditions, l’organisation de l’apprentissage, la formation de contremaîtres et chefs d’ateliers émérites sont des nécessités vitales. Nous ne disposons pas en France en 1938 des 1800 000 apprentis répartis dans les écoles allemandes en 1937, ni même des 500 000 de 1934. Or, du fait des dernières lois sociales, nous avons de plus en plus besoin d’apprentis, et même d’excellents apprentis susceptibles de faire de bons agents de maitrise […]
« L’organisation de l’apprentissage a été réglée dans les sociétés nationales par un additif à la Convention du14 Avril 1938. Ce texte oblige les Sociétés à former des apprentis en nombre égal à 3% de l’effectif total, soit environ 4% de l’effectif ouvrier ». Dans son rapport, Métral insistait, non seulement sur la nécessité d’une extension de l’apprentissage, mais aussi d’une évolution de son contenu pour l’adapter aux nouvelles techniques de production et d’organisation du travail. « En ce qui concerne l’apprentissage et la formation professionnelle, nous ne saurions trop insister sur la nécessité de réviser entièrement les principes de formation et d’enseignement […] De même que la Mécanique n’est plus scholastique, de même que la physique supérieure n’est plus celle du continu mais est devenu quantique et ondulatoire, de même les méthodes utilisées pour l’apprentissage ne doivent plus avoir pour base exclusive le travail manuel à une époque où les principes d’automaticité de la machine-outil et les notions de rendement économiques éliminent les assemblages à queue d’aronde ajustés à la main. Il est par contre indispensable de placer l’apprenti sur les machines les plus modernes et non user de vieilles machines, dont seul un ouvrier remarquable pouvait tirer le même rendement. Nous ne pouvons développer ici plus avant cette question ; nous dirons seulement que les mêmes problèmes doivent être étudiés et de façon particulièrement urgente pour la formation des cadres de maîtrise, où la pénurie, de l’avis unanime, se fait gravement sentir »[54]. Encore faut-il que le nivellement des rémunérations ne décourage pas « l’homme qui accepte l’effort d’un apprentissage sérieux », ce à quoi aboutirait un nivellement des salaires. « Il est donc indispensable que le contrat collectif ne fixe pas un prix horaire unique applicable à toutes les catégories d’ouvriers ‘une même industrie, car l’on ira aussitôt vers la dégradation de la production et la stérilisation complète de l’économie nationale ».

L’atelier-école d’apprentissage à l’usine de Bourges de la SNCAC, source: site departement18.fr
La nécessité de développer l’apprentissage faisait l’unanimité des responsables ministériels à la CGT, en incluant la direction des entreprises. Les syndicats demandaient le développement de centres de formation pour le reclassement des chômeurs, on parlait couramment alors de ‘rééducation’. Cette « rééducation » d’un chômeur était alors évaluée à 5000 Francs par an, selon une note de Claude Bourdet. Il faudrait donc 50 millions pour former dans la région parisienne les chômeurs ‘rééducables’, estimés à environ 10 000, sur 25 000 de moins de trente ans recensés dans cette région[55]. On estime alors que ce coût peut être amorti en 150 jours, « chaque chômeur reclassé comme ouvrier qualifié permet en moyenne, outre son propre embauchage, celui d’un manœuvre supplémentaire »[56]. Revenant des illusions de 1936, Daladier estime que, sur 360 000 chômeurs, « c’est à peine si 200 000 d’entre eux sont récupérables »[57]. Ce potentiel sera loin d’être exploité, les crédits inscrits au budget de 1938 étant limités à 3 millions de Francs. Paul Marchandeau, ministre des Finances, considère que le coût de cette opération doit être pris en charge par la Défense Nationale.
L’effort de formation devait se renforcer à l’approche de la guerre, bien tard pour faire sentir ses effets. Il y a surement eu là une occasion manquée pour pallier au déficit de main d’œuvre qualifiée affectant l’industrie aéronautique.
Entretemps, l’année 1938 aura vu monter les critiques contre le dispositif social mis en place en 1936, sous la pression de la menace hitlérienne. La politique sociale française prendra alors un nouveau cours, dans lequel l’industrie aéronautique se trouvera à nouveau au première ligne.
Et si…
En regrettant, voire en dénonçant au regard des évènements à venir, l’incapacité du Front Populaire à « faire marcher de pair le progrès économique et le progrès social »[58], on oublie combien la société française d’avant-guerre était profondément divisée, et pas seulement dans son attitude face à la menace hitlérienne. On manque de fondements historiques pour proposer un scénario idéal où l’effort de réarmement aurait rencontré une volonté de modernisation, rompant avec le malthusianisme ambiant sans exacerber les conflits sociaux. Peut-on imaginer une autre issue des élections de mai 1936 ? une autre configuration des alliances et des programmes politiques, plus favorable à l’émergence d’un réformisme fédérateur ? L’exercice est bien difficile sans remonter à la gestion déplorable de la crise économique dans les années 1932-1935. C’est alors un sujet beaucoup plus vaste qu’il nous faudrait aborder.
Dans les conditions qui prévalaient alors, la suite allait montrer que les mesures contraignantes nécessaires au redressement de la production, loin de résulter d’un processus consensuel, suivraient en fait l’échec de la grève générale du novembre 1938, ouvrant la voie à une nouvelle expérience sur laquelle nous reviendrons. Intervenu dans un climat que l’on a pu parfois qualifier de ‘revanche sociale’, ou du moins perçu comme tel, le redressement engagé, d’ailleurs trop tardivement, n’allait pas contribuer à renouveler l’adhésion des milieux ouvriers à une nouvelle ‘Union Sacrée’, au moment où le pacte Germano-soviétique venait fracturer la légitimité de la principale organisation syndicale.
Notes et références
[1] Dans son ouvrage de 1942, On s’est battu dans le ciel, p.28.
[2] Victor Laurent-Eynac, déposition à l’instruction du procès de Riom, 9 janvier 1941, SHD AI 11Z12962, p. 6.
[3] Albert Métral, dans son Rapport d’avril 1938, p. 81. SHD AI 11Z12934
[4] Herrick Chapman, L’Aéronautique, Salariés et patrons d’une industrie française, 1928-1950, traduction de : State Capitalism and Working Class Radicalism in the Fench Aircraft Industry, p. 102.
[5] Antoine Prost, Les grèves de mai-juin 1936 revisitées, Le Mouvement Social, n° 200, 2002 (3), pp. 33-35.
[6] Chapman, op. cité, p. 116.
[7] Ibid. p.118.
[8] Emmanuel Chadeau, L’industrie aéronautique en France 1900-1950, de Blériot à Dassault. Aussi Chapman, op. cité, p. 118.
[9] Robert Frankenstein, Le prix du réarmement français, p. 236.
[10] Le prix du réarmement, p. 237.
[11] Décret du 7octobre, cité par Michel Margairaz, L’Etat, les finances et l’économie, chapitre XIII, p.8. Cet historien remarque que les commissions tripartites par secteur anticipaient sur les commissions du Plan Monnet, parfois avec les mêmes participants.
[12] Situation de l’industrie aéronautique, rapport présenté le 12 octobre 1937, SHD AI Z11606.
[13] Elizabeth du Réau, L’aménagement de la loi instituant la semaine de quarante heures, in René Rémond et alii, Edouard Daladier, chef de gouvernement, p. 131.
[14] Rapport Métral, p. 82.
[15] Cité par M. Margairaz, op. cité, p. 18.
[16] Rapport cité, 12-10-37, SHD Z11606/2.
[17] Annexe au rapport Roos, ibid. p. 17. Ambroise Croizat (1901-1951), secrétaire général de la Fédération CGT des Métaux et député communiste, devait être après-guerre ministre du travail et considéré à ce titre comme l’un des pères de la Sécurité Sociale.
[18] Roos, op. cité, p. 11.
[19] Rapport Ross précité, p. 8.
[20] Roos, Situation de l’industrie aéronautique, 12-10-37, SHD Z11606/2.
[21] Histoire économique de la France, tome 2, p. 64. Cf. aussi : Une erreur de politique économique, la loi des quarante heures, Revue Économique, vol 25, 1974, p.699. Cf. aussi M. Margairaz, op. cité, p. 17.
[22] Pierre Villa, Une explication ds enchaînements macroéconomiques sur l’entre-deux-guerres, Le Mouvement Social, mars 1991, p. 239.
[23] Chapman, L’Aéronautique, salariés et patrons d’une industrie française, pp. 114-115.
[24] Déposition à l’instruction du procès de Riom, 25-09-1940, SHD 11Z12961.
[25][25] Chapman, op. cité, p. 230.
[26] Déclaration à l’instruction du procès de Riom,19 octobre 1940, p. 7, SHD AI 11Z12962 .
[27] Déposition à l’instruction du Procès de Riom,22-10-1940, p.2.SHD AI 11Z12965.
[28] Résumé de la délibération du 15-12-38, in SHD 11Z12934/8.
[29] Chapman, op. cité,p. 230.
[30] Chapman, op. Cité, 234-235. Margairaz, L’Etat, les Finances…, Ch 13, p. 21.
[31] Rapport cité, p. 72.
[32] Emmanuel Chadeau, L’industrie aéronautique en France 1900-1950, p. 320.
[33] Rapport Roos précité, p ; 7.
[34] Plan de fabrication in SHD11Z12934/5.
[35] Ibid. p. 5.
[36] Dans sa déposition à l’instruction du Procès de Riom,22 octobre 1940, p.4, SHD AI 11Z12965.
[37] Tableau sans titre, in SHD Z11606.
[38] Fédérations des techniciens, dessinateurs et assimilés de l’industrie, 1937, cité par Chapman, op. cité, p. 148.
[39] Cf Chapman , op. cité, p. 149.
[40] Déposition de l’ingénieur en chef Pierre Franck à l’instruction du Procès de Riom, 19 septembre 1940, SHD AI 11Z12961.
[41] La première usine de l’aviation nationalisée est inaugurée à Bouguenais près de Nantes, Le Populaire, 21 juillet 1937, p. 3.
[42] Selon M. Olive, administrateur-délégué de la SNCAO, déposition au procès de Riom, p.8.
[43] Cf. sa déposition à l’instruction du procès de Riom, 37-09-1940, p. 3, SHD AI 11Z12960.
[44] Chapman, op. cité, p.152.
[45] A. Prost, art. cité, p. 46.
[46] Texte repris dans La condition ouvrière, 1951, p. 171.
[47] A. Prost, art. cité, p. 45.
[48] PV du CoMat, 14-10-38, SHD AI 1B06.
[49] Cf. l’encadré suivant.
[50] Rapport en SHD AI 11Z12937.
[51] Déposition à l’instruction du Procès de Riom, 19-09-1940, p. 2. SHD AI 11Z12961.
[52] Chadeau, op. cité, p.320.
[53] Rapport Métral, p. 82.
[54] Métral, rapport cité, p. 83.
[55] Alors chargé de mission au Ministère des Finances, Bourdet sera, après-guerre, l’un des fondateurs de l’hebdomadaire L’Observateur.
[56] Margairaz, L’Etat, les Finances…, ch XIV, p. 32.
[57] En juillet 1938, cité par Margairaz, op. cité, p. 31.
[58] Décret du 7octobre 1937, cité par Michel Margairaz, ibidem.

Article très intéressant qui me fait découvrir une des causes de l’échec de l’armée de l’air en juin 1940.
A noter que les liens des 6 dernières illustrations ne fonctionnent pas.
Merci pour votre travail.